La Langue de chez nous
Anne-Marie Vurpas
Si, ce samedi 17 janvier 2015, aux cours de parler lyonnais suivi par 150 sociétaires de la Société des Amis de Lyon et de Guignol il règne une effervescence inhabituelle, c'est parce qu'aujourd'hui nous recevons Anne-Marie Vurpas qui a initiée avec notre président Gérard Truchet les premiers cours de Parler lyonnais en 1998.
Elle avait alors 75 ans et quand Gérard lui a demandé si elle acceptait de l'aider, elle répondit : " de tout cœur ". Et pendant plus de dix ans elle s'est investie à ses côtés avant de céder la place à Jean-Baptiste Martin linguiste émérite professeur de l'Université Lumière-Lyon II.
Tous deux partagent la même passion pour la sauvegarde des langues régionales. 
Ce dernier comme de bien s'accorde rend hommage à Anne-Marie Vurpas en soulignant son parcours, l'importance de son travail de chercheuse à l'institut Gardette (Université catholique de Lyon). Il rappelle que très jeune, alors qu'elle terminait ses études en licence de lettre classique et linguistique, elle parcourut à bicyclette le Beaujolais et les communes du nord du département en réalisant des entretiens pour permettre l'élaboration du prestigieux ouvrage : Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais. Travailleuse infatigable, elle a concouru à l'édition de plus de 12 ouvrages contribuant ainsi à la conservation du patrimoine linguistique ainsi qu'au développement et à la connaissance de la francophonie. Aujourd'hui, à nonante et un an (91), elle vient nous présenter son étude sur le manuscrit de G.-F. Vincent daté de 1797 qui reprenait les mots du parler Lyonnais pour en indiquer la correspondance en français. Il s'agissait à cette époque de la Révolution d'éliminer les patois régionaux. Ce dictionnaire qui contient une partie des mots de "Guignol", nous permet de connaître le parler Lyonnais du XVIIIème siècle.
Jean-Baptiste Martin souligne que chaque fois qu'une langue disparait, c'est une partie du patrimoine linguistique de l'humanité qui disparaît. Le français n'est pas une langue "Une" mais la somme de multiples langues régionales. " Les langues et les accents sont pour l'oreille, ce que l'architecture et la nature sont à l'œil " déclare-t-il.
A la fin du discours, de chaleureux applaudissements rendent un hommage appuyé à Anne-Marie Vurpas.

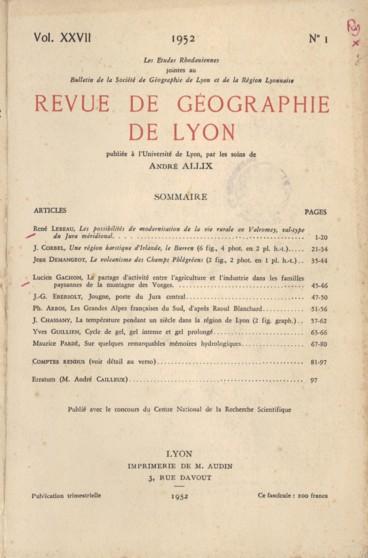



Sur la première photo tout le monde est attentif à l'hommage de Jean-Baptiste Martin.
Sur la seconde, nous avons de gauche à droite : Claudine Fréchet qui a collaboré à la réalisation de l'ouvrage en sa qualité de professeure en Sciences du Langage et directrice de l'Institut Gardette et la fille d'Anne-Marie assise à côté de sa maman -
Enfin sur la troisième photo aux côtés d'Anne-Marie, nous apercevons René Berlivet éditeur, responsable des Editions "Les Traboules" et Gérard Truchet président de la Société des Amis de Lyon et Guignol.
Un mot de Lyon et de sa région par Jean-Baptiste Martin
Gouttière
On prétend qu’à Lyon, pour boucher une gouttière, le maçon prend une tuile un peu plus loin sur le toit - (Nizier du Puitspelu)
Le grand vent de la semaine dernière m’a fait des gouttières .. (Vurpas-Michel)
En français standard, comme l’indiquent les dictionnaires usuels, le mot gouttière désigne le canal ouvert qui reçoit les eaux de pluie à la base d’un toit. Chez nous, c’est le mot chéneau (souvent prononcé cheneau et employé au féminin) venant du latin canalis « tuyau, conduit d’eau » qui désigne cette réalité.
Dans notre région, comme dans le sud, le centre et l’est de la France, le mot gouttière désigne ordinairement un défaut du toit (fissure, trou, déplacement de tuile ou d’ardoise) laissant passer l’eau de pluie qui coule le plus souvent goutte à goutte. Le mot peut aussi désigner l’infiltration elle-même (ex. « Avec le gel une tuile a dû se fendre, il y a une gouttière au grenier »). Ce régionalisme sémantique (seul le sens est régional) est également employé en Suisse romande, comme le montre l’exemple suivant cité par le Dictionnaire suisse romand : « Et la gouttière de notre logement est-ce qu’on va la réparer ?…chaque fois qu’il pleut on a de l’eau dans la chambre et ma femme est obligée de mettre un seau ».
Gouttière peut également désigner toute infiltration anormale ne provenant pas du toit (ex. « Il y a une gouttière au plafond, il doit y avoir une fuite dans l’appartement en dessus »).
Le mot gouttière est un dérivé de goutte, venant du latin gutta. Comme, en général, l’eau s’écoule goutte après goutte, ce régionalisme est très motivé, ce qui explique sa grande vitalité.
Il faut savoir qu’en français standard gouttière a d’abord signifié « bord inférieur d’un toit d’où l’eau goutte quand il pleut » et que c’est par métonymie que gouttière a pris le sens de conduite fixée au bord du toit pour permettre l’écoulement des eaux de pluie. C’est ce premier sens, aujourd’hui disparu ou vieilli, qui explique la locution bien connue chat de gouttière « chat d’espèce commune ».
Bambanner
Mon bourgeois1, qui était un moraliste, disait qu’il valait mieux s’occuper honnêtement à boire que de perdre son temps à se bambanner sans rien faire (Nizier du Puitspelu),
Je bambanne dans mon lit le dimanche matin (Vurpas-Michel)
Employé intransitivement ou pronominalement, le verbe bambanner (écrit aussi bambaner) signifie « flâner, se promener sans but, bague- nauder, traîner» (cf. exemples ci-dessus). Ce mot est employé dans le Lyonnais, le Beaujolais et dans la partie centrale et occidentale de Rhône-Alpes.
Le déverbal bambanne, qui peut être employé au masculin ou au féminin, signifie « lambin, flâneur, indolent », comme le montre l’exemple suivant extrait du Dictionnaire du français régional du Beaujolais :
« Il n’est pas pressé, c’est un vrai bambanne ». Dans le sud de la région, il est aussi utilisé avec le sens « fêtard, qui aime boire » (ex. « Ces bambannes ont fait la fête toute la nuit »).
Le mot bambanne qui, comme le verbe correspondant bambanner, figure dans la plupart des recueils de lyonnaisismes, a été relevé pour la première fois au milieu du XVIIIe siècle par l’Angevin Gabriel-Joseph Du Pineau lors du séjour qu’il effectua à Lyon, mais avec un sens un peu différent puisque ce dernier a proposé la définition suivante : « Un grand bambanne : niais, George Dandin 2».
Bambanner et banbanne sont des formations onomatopéiques. Ils viennent du radical bamb- qui est aussi à l’origine des mots français bamboche (français familier) et bambin.
- Chef d’atelier (terme de canuserie).
- Un George Dandin (terme signalé comme vieilli par les dictionnaires français) est un mari trompé ridicule (d’après le nom du héros de la comédie-ballet de Molière George Dandin ou le mari confondu).


