Les principales caractéristiques de la langue de Guignol
Les principales caractéristiques de la langue de Guignol
la langue de GuignolPar Jean-Baptiste Marin
Si, au début de XXIe siècle, le français parlé à Lyon est peu marqué régionalement, il en allait tout autrement au XIXe siècle, époque où le bruit des métiers à tisser rythmait la vie des Lyonnais, et en particulier celle des habitants de la Croix-Rousse. Les canuts (on appelait ainsi les ouvriers des manufactures de soie) s'exprimaient alors dans un français populaire et très marqué régionalement.
C'est dans cette langue populaire que s'exprimait Guignol, la célèbre marionnette créée par Laurent Mourguet, et que, par la suite et dans son sillage, fut écrite une littérature pittoresque et frondeuse. Le succès du théâtre et de la presse satirique de Guignol a permis à cette langue de traverser deux siècles sans grande évolution, de sorte qu'aujourd'hui elle revêt un caractère largement désuet et artificiel. Quand je parle de la langue de Guignol, je parle de la langue du Guignol lyonnais et non du Guignol qu’on a fait parler dans d’autres régions. J’ai, en effet, remarqué que le parler du Guignol de certains textes parisiens du début du XXe siècle est plus proche du parler des Parisiens de souche, je pourrais presque dire du parler des membres de l’Académie française, que du parler des canuts du XIXe. La langue de Guignol, au temps des canuts, se caractérise par l'emploi de mots ou d'expressions populaires et surtout par l'emploi de nombreux termes régionaux. Elle utilise des régionalismes encore vivants actuellement, mais aussi beaucoup de régionalismes qui étaient courants au XIXe siècle et au début du XXe, mais qui sont aujourd'hui inusités ou connus seulement de quelques vieux Lyonnais de souche.
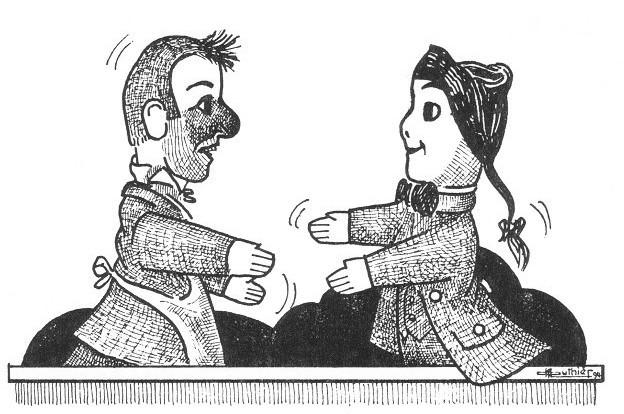
Quelques caractéristiques de la prononciation lyonnaise
Bien qu'aujourd'hui il ait souvent disparu, même chez beaucoup d'autochtones, il existe un accent qui permet de reconnaître un Lyonnais de souche. En effet, comme l'écrit Mgr Lavarenne, auteur de nombreux livres sur Lyon, "ce que nous gardons forcément, même quand nous tâchons de nous défaire de nos défauts de prononciation pour faire plaisir aux Parisiens, c'est notre accent…" (Nous autres les gones, p. 21). Le français parlé à Lyon a, comme c’est le cas dans toutes les régions, conservé quelques traits de la langue parlée avant le français, à savoir ici le francoprovençal.
Le trait de prononciation le plus caractéristique est le rapprochement du a avec le o ouvert. Cette prononciation se retrouve dans des mots comme candidat prononcé candidât, avocat prononcé avocât, rave prononcé râve. Une autre particularité importante est la fermeture du eu dans certains mots, par exemple feuille, jeune, fleuve, main-d'œuvre, veuve. Ainsi un Lyonnais de souche prononce jeune comme jeûne.
Le rapprochement du o ouvert avec eu ouvert constitue un autre trait de la prononciation lyonnaise. Bord a tendance à se prononcer comme beurre, mort comme meurt.
Pour les consonnes, le Lyonnais a tendance à réduire ly en y dans des mots comme tablier, escalier, soulier prononcés tabier, escayer, souyer ou à prononcer iy au lieu de y dans des mots comme Lyon, pieux, lier, prononcés Liyon, piyeux, liyer.
Comme les anciens canuts, les Lyonnais qui perpétuent la langue de Guignol :
-
prononcent thiâtre pour théâtre, borgeois pour bourgeois, gigier pour gésier, pipa pour papa, penable pour pénible, cintième pour cinquième, méquier pour métier,
-
élident le l devant consonne (ex. quelque qui devient quèque) ou le transforment en r (almanach devient armanach),
-
remplacent le r par un l en position intervocalique (ex. colidor au lieu de corridor), ajoutent une voyelle initiale à certains mots : boutonner devient aboutonner, regarder devient aregarder, copeaux devient écopeaux, spectacle devient espectacle, ajoutent à d'autres mots une consonne initiale (évier devient lévier) ou une consonne finale (eux est prononcé eusses),
-
inversent certains sons (ébréché devient éberché, cimetière devient cemitière) ou en transforment d'autres (édredon devient égledon).
On trouve aussi dans la langue de Guignol des déformations phonétiques dues à un maniement volontairement naïf ou maladroit du français (probable devient probabe tandis que municipal devient municipable) ou à des rapprochements cocasses avec des mots aux sonorités proches (ex. médecin devient merdecin, trait d'union trait d'onion, rhinocéros rhinoféroce, voix de stentor voix de centaure, eau minérale eau misérable).
Ces prononciations et ces déformations donnent à cette langue un caractère artificiel et comique que ne font qu'amplifier les créations expressives telles que esprité formé sur esprit, explicationner formé sur explication, lentibardaner (flâner) formé par rapprochement de lanterner et bardane (punaise des lits).
Régionalismes sémantiques
Certains mots existent en français standard mais ont un sens particulier dans la région lyonnaise. Parmi les exemples les plus employés dans la langue de Guignol, on peut citer vogue « fête foraine », pot « bouteille de vin de 46 cl. qu’on sert dans les bistrots », gouttière « défaut dans la toiture qui laisse pénétrer l’eau de pluie », phare « poêle à charbon », cornet « tuyau de poêle », éclairer « allumer (le feu, la lampe) », carotte rouge « betterave comestible », racine « carotte », choisir « préparer (les légumes) », censément « évidemment ». À ces exemples on peut ajouter, bien qu'il n'existe pas en français commun, manquablement qui signifie « immanquablement ».
Mots populaires ou argotiques
La langue de Guignol se caractérise aussi par l'emploi fréquent de mots ou d'expressions populaires comme cani « bistrot », gadin , « tête », fumerons « jambes », grolles « vieilles chaussures », avoine de curé « poivre », fla-fla « chichi », ratichon « curé » (ce mot a aussi le sens « correction, raclée »), à la revoyure « au revoir ».
Eléments de grammaire
Sur le plan grammatical, le français actuellement parlé à Lyon est peu différent du français parlé dans les autres régions. Il comporte cependant quelques traits grammaticaux particuliers qu’on retrouve souvent dans la langue de Guignol.
Le trait grammatical le plus vivant est sans conteste l’emploi de y comme complément d’objet direct neutre (ex. j’y dis mais j’y fais pas) puisque les plus jeunes enfants l’apprennent dans les cours d’école quand ils ne l’entendent pas en famille (cas des familles où les parents ne sont pas originaires de la région).
Parmi les autres caractéristiques, on note :
- l'utilisation de l'adjectif possessif mien (tien, sien, nôtre…) après ça dans le sens de "ce qui m'appartient, t'appartient…" (ex. ça mien est moins grand que ça vôtre).
- l'inversion des pronoms par rapport au français (ex. je vais lui le dire).
- l'utilisation de participes tronqués (ou adjectifs verbaux) pour indiquer l'état (et non l'action) comme arrête pour arrêté (ex. l’horloge est arrête), gâte pour gâté (ex. ces pommes sont gâtes), gonfle pour gonflé (ex. j’ai trop mangé et je suis gonfle), trempe pour trempé (ex. il est revenu trempe comme une soupe).
- la construction transitive directe des verbes ressembler et sembler qui est employé dans le sens « ressembler » (ex. il semble son père).En plus de ces caractéristiques, la langue de Guignol utilise d'autres tours dont certains correspondent, eux aussi, à l'ancienne langue francoprovençale : le relatif que employé aussi bien comme sujet que comme complément (ex. l'homme que vient),
- l'article partitif ou indéfini de à la place de du, de la, des (ex. il mange de pain et de confiture),
- la forme te à la place de tu pour le pronom personnel sujet de la deuxième personne du singulier (ex. te viens),
- l'emploi de je à la place de nous à la première personne du pluriel (ex. je venons).
D'autres tours correspondent à un maniement comique ou faussement naïf de la langue française. Guignol et ses continuateurs :
-
disent des animals ou des chevals,
-
emploient perçoivre et reçoivre à la place de percevoir et recevoir, être de croire à la place de être croyable,
-
utilisent le subjonctif imparfait à la place du subjonctif présent (ex. elle ne veut plus que je la fréquentasse),
-
juxtaposent des adverbes de quantité de même sens (par exemple si tant au lieu de si ou de tant),
-
mettent le verbe au pluriel après le monde employé dans le sens de "les gens" (ex. « Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut bien d’un peu partout » est une des maximes de la Plaisante Sagesse lyonnaise).
La langue de Guignol se caractérise surtout par l’emploi de nombreux régionalismes lexicaux dont la plupart viennent du substrat dialectal francoprovençal. Il est impossible de tous les citer ici, car il y en plusieurs centaines et on les trouve dans tous les champs sémantiques.
Pour donner un aperçu de ce vocabulaire, voici les mots qu’Anne-Marie Vurpas et moi-même avons mis dans le chapitre « Caractère, qualités et défauts, comportement » de l’ouvrage Le parler des gones des origines à aujourd’hui (Le Poutan, 2019).
Il existe plusieurs mots (adjectifs ou noms) pour désigner le naïf ou le niais : babian, benoni, bredin, brelaud, foutraud. Etre une grande bugne, c'est être maladroit et empoté (peut-être parce que cette friandise bien lyonnaise n'a pas de contour bien défini).
Un caquenano est un homme bête et frustre, un grand gognand est un homme bête et maladroit. Une gognandise est une bêtise ou une plaisanterie (ce mot lyonnais a aussi été donné récemment à une confiserie lyonnaise).
Un traîne-grolles est un traînard tandis que quelqu'un qui est démenet est dégourdi.
Le lexique de Guignol est également riche en mots gentiment moqueurs.
Un niais peut être appelé un niquedandouille (à la fois nigaud et andouille) ou un nicodème.
Un homme timoré est un tâte-golet ou un pierre-qu'arrape (arraper, c'est accrocher, coller).
Le vaurien est un artoupan ou un artignol. Un vaurien est traité de galapian ou de pillandre.
Pour stigmatiser la mollesse ou la paresse, on utilise des mots évocateurs comme panosse dont le sens premier est « chiffon, serpillière », sampille dont le sens premier est « loque, guenille » et qui peut aussi désigner un vaurien.
On traite l'indécis ou le bon à rien de cogne-mou ou de couâme.
Quant aux femmes sottes et niaises (je tiens à préciser qu’il y en a très peu), ce sont des gnioches ou des gnougnes.
Une catolle est une bigote mais aussi une femme médisante et un peu hypocrite.
On traite de pignoche ou pignochon quelqu'un qui pignoche, c'est-à-dire mange sans appétit ou travaille avec lenteur.
Celui qui n'inspire pas confiance ou qui a mauvaise allure est un marque-mal.
On dit qu'un enfant est bougeon quand il ne tient pas en place, tarabate quand il s'agite beaucoup. On le traite de tourmente-chrétien s'il est difficile à supporter. Quand il fait des rats (caprices), il reçoit parfois des revire-marion (gifles).
Les femmes qui ont une réputation douteuse se font traiter de fumelles (forme locale de femelle) ou de poutrônes (mot désignant la poupée en francoprovençal lyonnais) ou encore de margaudes (dérivé péjoratif de Margot).
Un coureur de jupon est un couratier.
Les mots lyonnais ne manquent pas pour désigner les qualités des femmes qui peuvent, par exemple, être chenuses (charmantes) ou canantes (agréables).
Un homme habile et dégourdi est artet ou démenet.
Les termes d'affection sont nombreux : mon belin, mon beson, ma coque, ma grabote, mon gratton, ma rate (mon chéri, ma chérie) sont utilisés à l’adresse des personnes de l’autre sexe ou des enfants.
Les verbes signifiant « embrasser » ne manquent pas, non plus : faire peter la miaille, biquer, bicoter, boquer, coquer.
Voici pour terminer mon propos sur ce thème quelques autres mots : achatir (embobiner), amater (amadouer), emboimer (enjôler), se cocoler (se blottir), être encarpionné (être fou d’amour).
Autre vocabulaire moins sympathique : les embiernes (les difficultés), les arias (les soucis), broger (ruminer ses pensées), se marcourer (se ronger de chagrin), faire flique (agacer, importuner), un fion (une remarque blessante, une pique), envoyer aux pelosses (envoyer promener, les pelosses sont les prunelles), un ratichon (une correction, une raclée).
J’espère que ces exemples vous ont donné un aperçu de la nature et de la richesse de ce qu’on appelle ici la langue de Guignol. Comme je vous l’ai indiqué au début de mon propos, celle-ci correspond au parler des canuts d’il y a deux siècles qui était alors fortement influencé par la langue vernaculaire locale. Comme Lyon est devenu une très grande métropole et a connu de profonds changements sur le plan sociologique, elle ne correspond plus au parler de la quasi-totalité des Lyonnais actuels. Si vous voulez entendre la langue de Guignol, il ne vous suffira pas de vous promener dans les rues de Lyon, il vous faudra aller dans un théâtre ou dans un spectacle où les continuateurs de Guignol (il y en a parmi nous) perpétuent avec talent la langue mais aussi l’esprit de Guignol.
Aujourd’hui, pour être compris, Guignol et ses comparses ne peuvent plus parler comme ils le faisaient au XIXe siècle ou au début du XXe, car la sociologie lyonnaise et la langue elle-même ont changé. Il doit donc s’adapter à la population actuelle des régions où il s’exprime et à leurs particularités linguistiques. L’intérêt de Guignol tient, en effet, au message transmis, mais aussi à la langue dans laquelle ce message est exprimé. Personnellement, je trouverais regrettable que, dans la région lyonnaise, Guignol s’exprime comme n’importe quel Français, par exemple un Parisien. Sinon, bientôt il finira par s’exprimer en globish. Et, alors, il aura perdu beaucoup de sa saveur et un peu de son âme.



